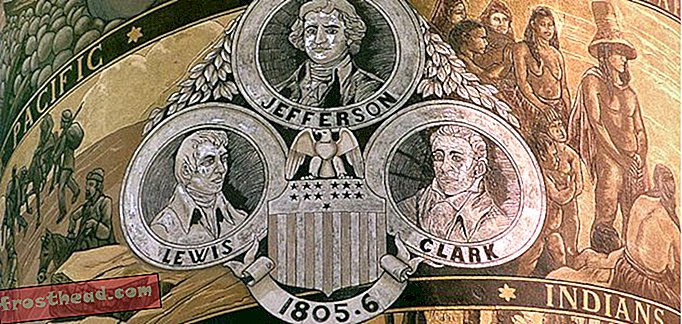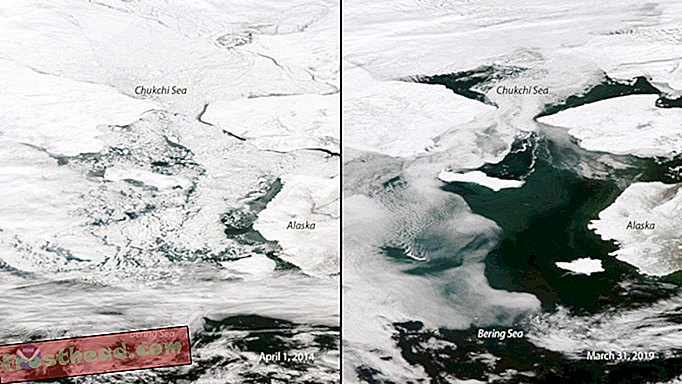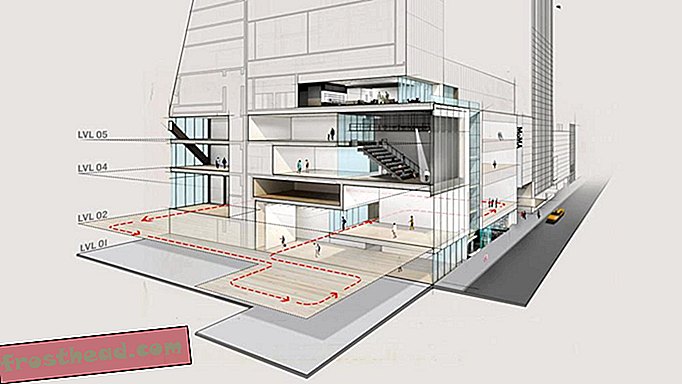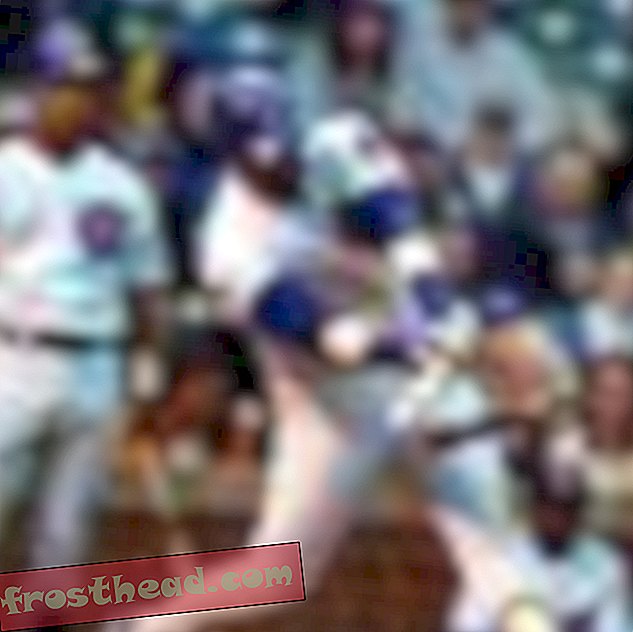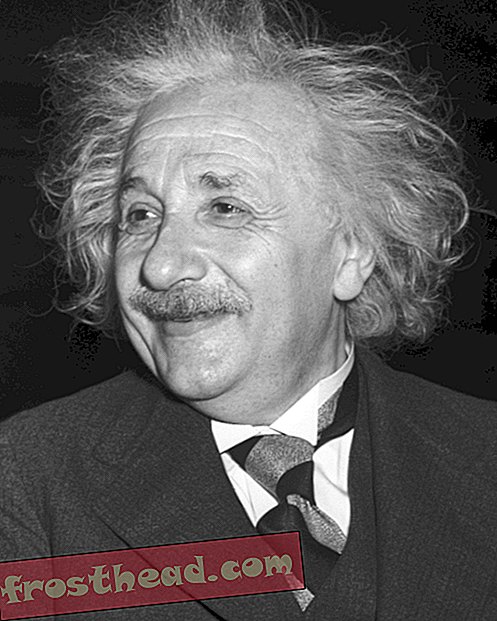C’est un typhon, dit-on en quelque sorte, qui a jeté David O'Keefe à Yap en 1871 et quand il a finalement quitté l’île 30 ans plus tard, c’est un autre typhon qui l’a noyé alors qu’il rentrait chez lui à Savannah.
Entre ces dates, O'Keefe s'est taillé une place de choix dans l'histoire du Pacifique. En ce qui concerne la presse, il l'a fait en se transformant en «roi des îles cannibales»: un Irlandais aux cheveux roux et demi-roux qui menait une existence tropicale idyllique était «le souverain de milliers» d'autochtones. et commandait «une armée permanente de douze sauvages nus». («Ils étaient sans instruction, mais ils le révéraient, et sa loi était la leur».) C’est cette version de l’histoire d’O'Keefe qui a fait mouche Un siècle plus tard, Sa Majesté O'Keefe (1954), un véhicule oublié de Burt Lancaster, et cette version, selon la spécialiste Janet Butler, est encore répandue parmi les descendants d'O'Keefe en Géorgie.
La réalité est assez différente et, à certains égards, encore plus remarquable. Car si O'Keefe n'a jamais été roi, il a certainement construit la société de négoce privée la plus prospère du Pacifique et, à un moment où la plupart des marchands occidentaux de la région exploitaient les insulaires avec lesquels ils traitaient, ils faisaient ensuite appel à des navires de guerre américains ou européens. pour les sauvegarder - il a travaillé étroitement avec eux, les a compris et a fait sa fortune en gagnant leur confiance et leur aide. Cela en soi rappelle à O'Keefe que, bien que l'ancien capitaine de marine fût assurément imparfait (il avait au moins trois femmes et plusieurs maîtresses et qu'il présentait l'alcool et les armes à feu aux Yapese), il est toujours rappelé avec tendresse l'Ile. Cela ne fait pas de mal, pour autant que l’histoire soit étrange, que O'Keefe se soit gratté sur Yap en s'assurant un monopole sur l’approvisionnement en monnaie unique de l’île: des pièces de monnaie géantes en pierre, chacune jusqu’à 12 pieds de diamètre et pesant jusqu'à quatre tonnes et demie. Mais attendez; nous devançons nous-mêmes.
Commençons par l'histoire compliquée qui a amené O'Keefe à Yap. Autant que l'on puisse en juger, le capitaine est né en Irlande vers 1823 et est arrivé aux États-Unis en tant que travailleur non qualifié au printemps 1848. Cette date suggère fortement qu'il était l'un des plus d'un million d'émigrants chassés d'Irlande. O'Keefe continua à voyager, contrairement aux nombreux Irlandais qui débarquèrent à New York et y restèrent - continuant à voyager, finissant par se laver à Savannah en 1854. Après avoir travaillé sur les chemins de fer, il partit en mer son chemin pour être capitaine de son propre navire. Pendant la guerre de Sécession, il aurait travaillé pour le blocus de la Confédération.
Quelle que soit la vérité, O'Keefe prospéra brièvement pendant la période de reconstruction avant que le tempérament chaud pour lequel il était connu ne lui causât de graves problèmes. En tant que capitaine des Anna Sims, amarré à Darien, en Géorgie, il s'est disputé violemment avec un membre de son équipage. Le marin a frappé O'Keefe avec une barre de métal; O'Keefe a riposté en tirant l'homme à travers le front. Il a passé huit mois en prison, accusé de meurtre, avant d'être acquitté pour légitime défense. À peu près au même moment, il était maintenant 1869, il avait épousé une adolescente de Savannah, Catherine Masters.
Ce qui a conduit O'Keefe de Géorgie reste un mystère mineur. La tradition familiale veut qu'il ait envoyé un deuxième membre d'équipage dans la rivière Savannah quelques mois plus tard; craignant d'avoir noyé l'homme, O'Keefe s'est enrôlé dans le paquebot Beldevere, fuyant vers Liverpool, Hong Kong et le Pacifique. Pourtant, rien ne semble indiquer que ce combat ait réellement eu lieu et il est tout aussi probable que l’affaiblissement des fortunes ait conduit l’Irlandais au désespoir. Un historien a fait remarquer qu’en 1870, O'Keefe avait été réduit à faire des excursions d’une journée sur la côte pour les pique-niqueurs.
Quoi qu’il en soit, le capitaine a quitté Savannah et il semble que peu de choses aient été entendues jusqu’à sa venue à Hong Kong à la fin de 1871, écrivant pour envoyer à sa femme une traite bancaire de 167 $ et promettant qu’il serait à la maison d’ici Noël… une promesse qu'il n'a pas remplie. La prochaine fois que Catherine O'Keefe a eu des nouvelles de son mari, il a écrit pour lui demander de lui envoyer le certificat de capitaine dont il avait besoin pour diriger un navire - un signe certain qu'il resterait dans le Pacifique. Au début de 1872, O'Keefe se trouvait à Yap, un petit archipel d'îlots connectés situés dans les Carolines.
Plus d'informations sur les aventures d'O'Keefe à Yap après le saut…
Il y avait de bonnes raisons d'aimer Yap. L'île se situe juste au-dessus de l'équateur dans la partie occidentale du Pacifique et était bien placée pour le commerce, étant à une distance de navigation de Guam, des Philippines, de Hong Kong et des Indes orientales (Indonésie). La population y était accueillante à une époque où ceux d’autres îles massacraient encore des étrangers. Et Yap était extrêmement fertile. Les cocotiers abondaient, ce qui rendait l'endroit attrayant pour les marchands de copra (chair de noix de coco séchée, source importante d'huile de lampe), tandis que les lagunes étaient remplies d'holothuries, la bêche-de-mer, un mets délicat d'Asie.
Selon des récits traditionnels, O'Keefe serait venu à Yap plus ou moins par hasard. Il aurait été emporté par un typhon et aurait été soigné et soigné par un homme yapais nommé Fanaway, qui lui aurait appris quelque chose de la langue locale. Cette version des événements est certainement ce que sa famille croyait, mais la tradition locale suggère que O'Keefe soit venu à Yap pour commercer, arrivant dans une jonque de Hong Kong nommée Catherine en l'honneur de sa femme, et qu'il aimait tout simplement l'endroit où il est resté. Quelle que soit l'histoire qui soit, cependant, il n'a pas tardé à se débarrasser des liens familiaux. Catherine O'Keefe n’a jamais été abandonnée - son mari a continué à lui envoyer des sommes importantes une ou deux fois par an, et le dernier brouillon tiré de son commerce à Yap a été reçu à Savannah aussi tard que 1936. Les lettres de O'Keefe à la maison, cependant, est rapidement devenu de moins en moins affectueux, les fermetures ayant eu lieu quelques mois après son arrivée, passant de «Ton mari aimant» à «Au revoir, vraiment à toi» à un «Vôtre bien décourageant, comme tu le mérites».
Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Catherine, qui se trouve à des kilomètres aux États-Unis, s'est vite estompée dans la mémoire de son mari. La vie dans le Pacifique n'était pas idyllique au début; O'Keefe, qui a été employé pendant quelques années par la Celebes South Sea Trading Company, a été envoyé dans le cadre d'une mission dangereuse dans les îles Hermit à la recherche de la bêche-de-mer . encore navigué en Mélanésie. Peu de temps après, il a perdu son emploi lorsque son patron a été tué par un coup de poing dans la tête contre Palau. Il a passé le reste des années 1870 à lutter pour créer sa propre entreprise. Cela impliquait d’établir un réseau de stations de négoce face à la concurrence, de recruter des agents européens d’une fiabilité douteuse sur les quais de Hong Kong et de Singapour, et d’ajouter lentement des voiliers à sa flotte: le Seabird en 1876, le Wrecker en 1877, le Queen en 1878 et la Lilla en 1880.
Deux épiphanies ont transformé O'Keefe, d'un autre commerçant, en un des plus grands marchands sur des milliers de kilomètres. Le premier a eu lieu lorsqu'il s'est rendu aux îles Freewill, au large de la côte nord de la Nouvelle-Guinée, au début des années 1870, et a reconnu le vaste potentiel commercial d'un îlot étroit appelé Mapia, long de 15 km et densément boisé de noix de coco. La plupart des Mapians ont été tués lors d'attaques lancées par le souverain de Ternate, situé à proximité. l'Irlandais s'est rendu chez le sultan et a conclu avec lui un traité donnant à O'Keefe le droit exclusif de récolter des noix de coco sur Mapia moyennant 50 dollars par an. En 1880, le petit sandspit produisait 400 000 livres de coprah par an; le sultan a tenu sa part du marché et a rejeté les commerçants rivaux désireux de prétendre à une partie de cette manne.
La deuxième épiphanie, qui ne s'est déclenchée qu'un peu plus tard, s'est abattue sur Yap même et a assuré à O'Keefe la loyauté éternelle des habitants de l'île. Alors que l'Irlandais connaissait mieux Yap, il réalisa qu'il y avait une marchandise, et une seule, que la population locale convoitait: la «monnaie en pierre» pour laquelle l'île était réputée et qui était utilisée dans presque toutes les transactions de grande valeur. Japper. Ces pièces ont été extraites de l'aragonite, une sorte de calcaire spécial qui brille à la lumière et qui a de la valeur car il n'a pas été trouvé sur l'île. O'Keefe a eu le génie de reconnaître que, en important les pierres pour ses nouveaux amis, il pouvait les échanger contre du travail dans les plantations de noix de coco de Yap. Les Yapais n’étaient pas très intéressés par la transpiration pour les bibelots du commerçant qui étaient monnaie courante ailleurs dans le Pacifique (c’est également ce qu’ils auraient dû faire, a concédé un visiteur, alors que «toute la nourriture, les boissons et les vêtements sont facilement disponibles, il n’ya donc pas de troc ni de dette "), mais ils travailleraient comme des démons pour de l'argent de pierre.
Les pièces de monnaie, connues sous le nom de fei, ont été extraites à Palau à une distance de 250 km. Leur taille variait de quelques centimètres à près de dix pieds de diamètre. Chacune était soigneusement sculptée et était plus épaisse vers le centre que sur les bords; chacun avait un trou percé au milieu, et les plus grands étaient transportés sur des poteaux que des gangs d'îliens traînaient. La valeur des pièces ne dépend toutefois pas uniquement de leur taille; cela a été mesuré par une formule complexe qui comprenait la reconnaissance de leur âge, de leur qualité et du nombre de vies perdues en les emmenant à Yap. Les plus grosses pièces de monnaie (qui appartenaient invariablement aux chefs) ne changèrent pas littéralement de mains quand elles étaient utilisées dans une transaction; ils étaient généralement installés juste à l'extérieur d'un village et restaient dans leur lieu habituel. L’anthropologue invité William Furness, découvert en 1908, semblait reconnaître chacun des 6 000 Yapés qui possédait quelle pièce, et certains pouvaient retracer cette propriété à travers des siècles de commerce.
Il n'était même pas nécessaire qu'une pièce de monnaie pour atteindre Yap ait de la valeur; Furness a raconté qu'un fei gigantesque avait été perdu lorsque le canot qui le transportait a coulé; suffisamment de survivants ont «témoigné de ses dimensions et de sa finesse» pour que sa valeur soit reconnue et il reste la précieuse propriété du chef qui a parrainé sa sculpture, même si celle-ci se trouve à plusieurs centaines de mètres de milles marins de la côte.
Les Yapais utilisaient peut-être le fei dès 1400, bien que les pierres fussent si difficiles à extraire avec des outils d'obus et ensuite à transporter qu'elles restèrent très rares jusqu'en 1840. Leur existence fut d'abord décrite par l'un des prédécesseurs d'O'Keefe, le Le commerçant allemand Alfred Tetens, qui en 1865 s'est rendu à Yap à bord d'un grand navire transportant "dix autochtones ... qui souhaitaient rentrer chez eux avec les grosses pierres qu'ils avaient taillées à Palau". Il ressort clairement de cela que les Yapais étaient désireux de trouver des solutions de remplacement au transport. en canot, et O'Keefe a répondu à cette demande. En 1882, il exploita 400 habitants de la province, soit près de 10% de la population.
Ce commerce avait ses inconvénients, notamment l’introduction de l’inflation, provoquée par l’augmentation soudaine du stock de monnaie. Mais cela avait beaucoup de sens pour O'Keefe. Les Yap, après tout, ont fourni le travail nécessaire, à la fois pour extraire les pierres et récolter les noix de coco à Yap. À l'époque de la navigation, les dépenses d'O'Keefe étaient minimes, à savoir quelques fournitures et le salaire de ses membres d'équipage. En retour, il a tiré parti des milliers d’heures de travail consacrées à la construction d’une société de négoce, d’une valeur estimée entre 500 000 et 9, 5 millions de dollars.
Riche à présent et sans serviteur, l'Irlandais se sentait libre de se livrer. Il a pris deux autres épouses - la première, restée à Mapia, était Charlotte Terry, fille d'une femme de l'île et l'ex-condamné employé pour gérer les affaires d'O'Keefe dans cette ville; la suivante, encore plus scandaleusement, était la tante de Charlotte. Cette troisième épouse, nommée Dolibu, était une insulaire du Pacifique originaire de Nauru. Largement considéré comme une sorcière qui avait pris O'Keefe au piège de la magie, Dolibu s'installa avec lui à Yap, eut plusieurs enfants et ordonna que le nom de sa nièce ne soit pas mentionné en sa compagnie.
Au début des années 1880, David O'Keefe était assez riche pour se construire une maison en briques rouges à Tarang, une île au milieu du port de Yap. Outre une grande bibliothèque de livres parmi les plus en vogue - le capitaine avait la réputation d'être un lecteur assidu - il importait un piano, des ustensiles en argent et des antiquités de valeur. Sa propriété comprenait quatre longs entrepôts, un dortoir pour ses employés, un quai avec des amarres pour quatre navires et un magasin appelé O'Keefe's Canteen qui vendait le rhum local à 5 cents la mesure. Il y avait toujours beaucoup de monde en ébullition: la cantine était dirigée par un homme nommé Johnny, réputé pour être un voleur, un ivrogne et un génie mécanique; Dolibu a été servie par deux cuisiniers et un domestique; et il y avait aussi une équipe de chargement de Yap qui payait «50 centimes par jour plus une bouchée et une boisson.» Et bien que Yap fût, en principe, une partie de l'empire d'outre-mer espagnol après 1885 (et allemand après 1898), O'Keefe a fait voler son drapeau Tarang —les lettres OK en noir sur fond blanc.
Il y a beaucoup de récits sur la gentillesse de O'Keefe envers les Yap, et il est peut-être trop facile, en rétrospective, de critiquer la vente de rhum et d'armes à feu aux insulaires; ceux qui ont visité Yap étaient catégoriques: l'Irlandais ne vendait de l'alcool que parce que des commerçants rivaux - ainsi que les gouvernements espagnol et allemand - le faisaient également. Il y avait cependant des limites à cette bienveillance et O'Keefe ne voyait certainement aucun mal à exploiter le vaste fossé entre les prix occidentaux et les revenus yapais. John Rabé, qui se rendit à Yap en 1890, déclara qu'O'Keefe avait échangé une pièce de monnaie en pierre de quatre pieds de diamètre - fabriquée par les Yapese eux-mêmes, mais qu'il avait importée sur l'un de ses navires - contre 100 sacs de coprah il a ensuite vendu pour 41, 35 $ par sac.
O'Keefe a bénéficié pendant presque 20 ans des fruits de son travail et de celui de ses hommes. Vingt ou trente voiliers par an font escale à Yap, devenu le plus grand entrepôt du Pacifique, et un grand paquebot jette l'ancre toutes les huit semaines pour ramasser le coprah et débarquer les marchandises. Bien sûr, tout cela a valu à l'Irlandais de l'hostilité, un visiteur remarquant qu'O'Keefe était «en guerre avec tous les autres Blancs de l'île, qui le détestaient tous profondément»; en 1883, le sentiment était si élevé que de nombreuses accusations de cruauté furent déposées lorsqu'un navire de guerre britannique fit escale dans l'île. Parmi celles-ci figuraient des allégations selon lesquelles des hommes de Yap servant sur la Lilla auraient été pendus par la main, fouettés ou jetés à la mer dans des eaux infestées de requins. Mais lorsque le capitaine du HMS Espiègle a enquêté, il a jugé les accusations «totalement infondées». O'Keefe, a-t-il statué, avait été malicieusement lésé par des rivaux «jaloux du succès de ses relations avec les indigènes».
Ce n'est que vers 1898 que la fortune d'O'Keefe s'est affaiblie. Les poux de la feuille - des ravageurs apportés sur l'île par le négoce de cargaisons - ont commencé à infester les plantations de Yap, réduisant la production de coprah à 100 tonnes par an; l'île a été frappée par deux typhons massifs, et l'indépendance obstinée du capitaine a déplu à l'Allemagne. Enfin, en avril 1901, O'Keefe a quitté Yap. Il laissa Charlotte et Dolibu derrière lui, mais emmena avec lui ses deux fils aînés, qui avaient apparemment l'intention de retourner enfin à Savannah.
Il n'a jamais réussi. En mai 1901, son bateau, la goélette Santa Cruz, a été pris dans un autre typhon et a sombré loin dans le Pacifique. L’Irlandais n’a jamais été revu, bien qu’un étrange récit de Guam raconte que six mois plus tard, un navire l’a appelé pour demander l’autorisation d’enterrer le corps d’un naufragé. Il avait été emmené accroché à un espar et mourait de faim, et s'appelait O'Keefe.
La nouvelle de la mort du capitaine a mis du temps à atteindre la Géorgie, mais elle a suscité un mélange d'horreur - lors des mariages bigames d'O'Keefe avec des femmes non-caucasiennes - et de la cupidité. Catherine, outrée de découvrir que la volonté de son mari cède sa fortune à Dolibu, a engagé un avocat de la Savannah pour se rendre à Yap et revendiquer ses biens. Malgré la promesse de revenir de Yap avec au moins un demi-million de dollars, l’homme finit par régler pour le compte de Catherine pour seulement 10 000 dollars. Mais pendant des années, jusqu'à sa propre mort, en 1928, elle hanta le palais de justice de Savannah, «une grande femme maigre… très érigée… toujours vêtue de noir funéraire» et espérant toujours obtenir «ce qui lui appartenait à juste titre».
Après que O'Keefe soit mort et que les Allemands aient été retranchés, les choses ont commencé à mal tourner pour les Yapese après 1901. Les nouveaux dirigeants ont ordonné aux insulaires de creuser un canal à travers l'archipel et, lorsque les Yapois se sont montrés réticents, ont commencé à réquisitionner leur argent en pierre., dégradant les pièces avec des croix peintes en noir et disant à leurs sujets qu’ils ne pourraient être rachetés que par le travail. Pire encore, les Allemands ont adopté une loi interdisant aux Yap de voyager à plus de 200 milles de leur île. Cela met un terme immédiat à l'exploitation de fei, bien que la monnaie continue à être utilisée même après que les îles aient été saisies par les Japonais, puis occupées par les États-Unis en 1945.
Aujourd'hui, Yap fait partie des États fédérés indépendants de Micronésie et la plupart des transactions quotidiennes sur l'île sont effectuées en dollars. La mémoire de David O'Keefe reste vivante sur l'île, cependant, et pas seulement sous la forme d'endroits tels que la Kanteen d'O'Keefe, qui accueille des touristes. L'argent de pierre de l'île est toujours échangé lorsque les Yap transfèrent des droits ou des terres. Et, même si elle est encore utilisée, un peu de David O'Keefe hante toujours l’île amicale qu’il aimait.
Sources
La plupart des récits de la carrière d’O'Keefe sont pour l’essentiel fictifs et il n’existe que deux sources fiables: sa thèse de doctorat: la thèse de doctorat de Butler et l’ article du Journal of Pacific History de Hezel. J'ai beaucoup utilisé les deux.
Anon Le roi O'Keefe de Yap. The Watchman et Southron (Sumter SC), 11 décembre 1901; «Les cannibales ont fait du capitaine O'Keefe un roi. New York Times le 7 décembre 1901; "Un Irlandais devenu roi". New York Tribune, 19 avril 1903; 'Veut l'île de Yap.' Evening Bulletin (Honolulu), 18 mai 1903; 'Roi de Yap enterré.' Savannah Morning News, 1er juin 1904; ML Berg. «La politique yapaise, la monnaie yapaise et le réseau hommage à Sawel avant la Première Guerre mondiale» Journal of Pacific History 27 (1992); Janet Butler. L'est rencontre l'ouest: à la recherche désespérée de David Dean O'Keefe de Savannah à Yap . Ed.D. non publié thèse, Georgia Southern University, 2001; William Henry Furness III, île de pierre en argent: Le filet des Carolines. Philadelphie: JP Lipincott, 1910; Francis X. Hezel. «L'homme réputé roi: David Dean O'Keefe. Journal of Pacific History 43 (2008); Cora Lee C. Gillilland, 'La pierre d'argent de Yap'. Smithsonian Studies in History and Technology 23 (1975); David Labby, La démystification de Yap: Dialectique de la culture sur une île micronésienne . Chicago: Presses de l'Université de Chicago, 1976; Willard Price, Les îles japonaises du mystère, Londres: William Heinemann, 1944; Allan Speedy, «Mythes about Yap stone money», http://www.coinbooks.org/esylum_v13n51a15.html, consulté le 2 juillet 2011.