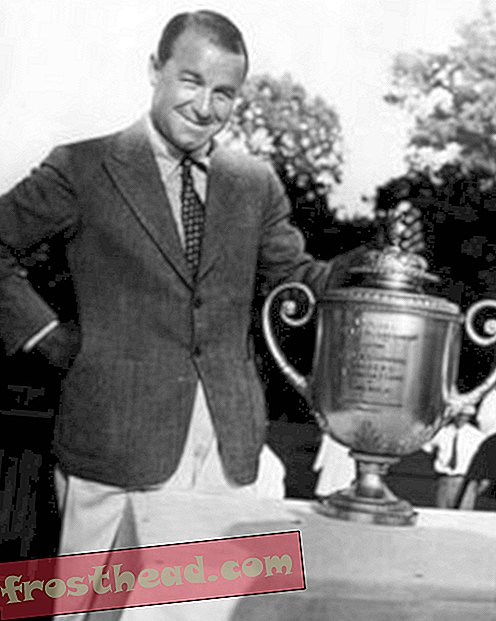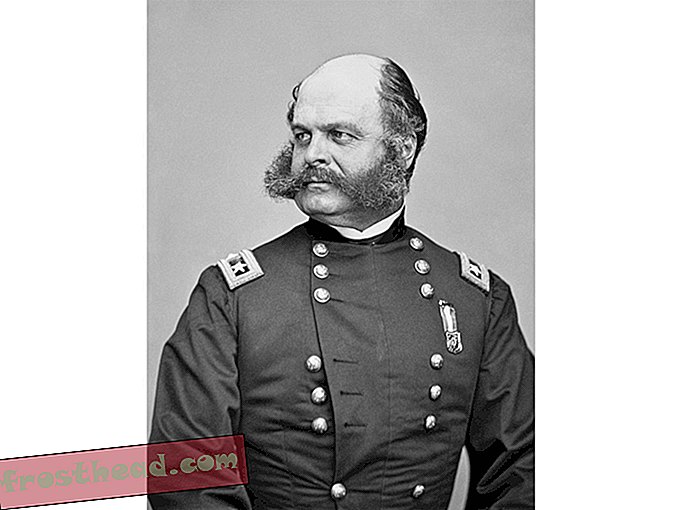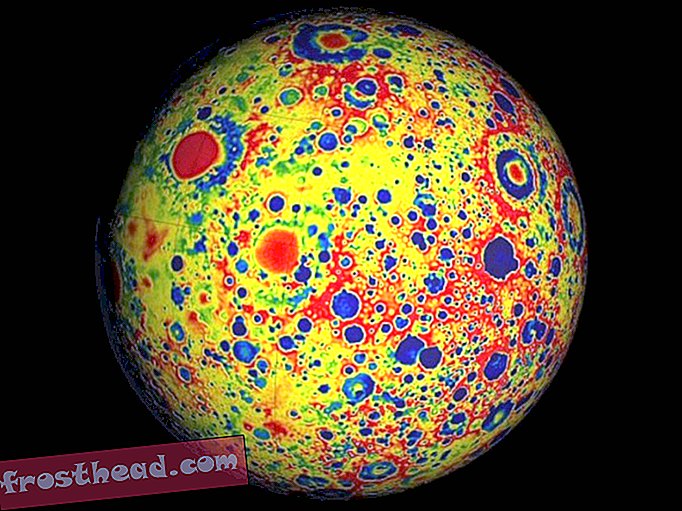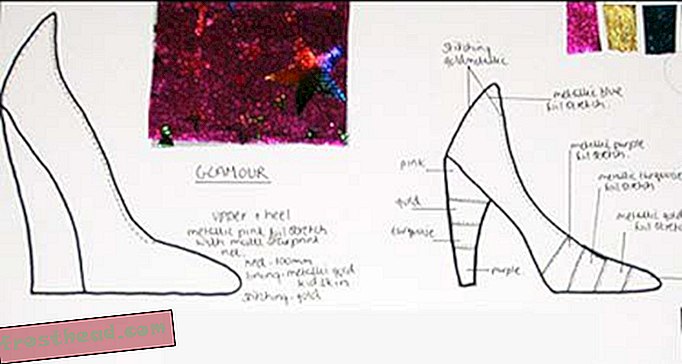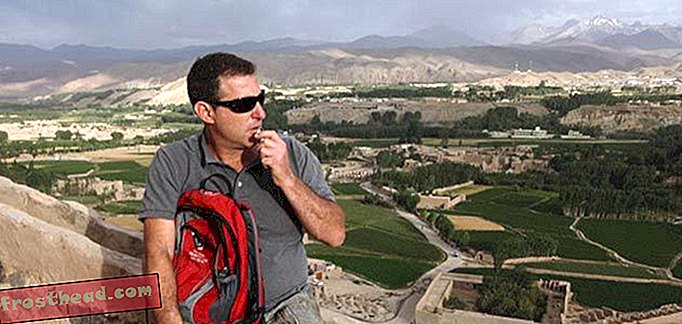Le canard du Labrador, le grand pingouin et le pigeon voyageur - ils sont disparus depuis longtemps, ils sont éteints depuis plus d'un siècle. Mais le photographe Denis Defibaugh a formé son objectif sur les spécimens zoologiques dans les musées d'histoire naturelle du pays, les amenant à une nouvelle vie étrangement belle dans son projet «Afterlifes of Natural History».
L’artiste basé à Rochester, à New York, se concentre sur les oiseaux, les insectes et les mammifères en voie de disparition et disparus, dans l’espoir d’attirer l’attention sur leur sort et de mettre en garde contre le déclin continu de nombreuses espèces. Il a commencé à photographier des spécimens au musée d'histoire naturelle du parc national de Zion en 2003 alors qu'il était en congé sabbatique de son poste de professeur à l'Institut de technologie de Rochester (RIT). Depuis lors, il a réalisé des portraits de près de 100 animaux.
«Les spécimens sont beaux à regarder, des œuvres d'art raffinées, ainsi qu'un artefact historique qui nous rappelle à quel point la vie est fragile», explique-t-il.
Depuis lors, Defibaugh poursuit une quête dans l’esprit des grands naturalistes - il considère le peintre ornithologue John James Audubon comme une influence importante sur son travail - afin de saisir des spécimens rares dans les collections du Field Museum de Chicago, du Cornell Lab of Ornithology et de Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian. Faire ainsi avec le film de type 55 - un film presque neuf ans plus tard - et une technique qui numérisait les négatifs alors qu'ils continuaient à se développer et à se désintégrer dans le noir semblaient tout à fait appropriés.
Initialement publié en 1961, le Polaroid Type 55 est un film noir et blanc au format 4x5 qui crée à la fois une impression positive et un négatif. Ils sont encadrés par des rangées de points ressemblant à des mailles sur un côté et des arêtes vives sur les trois autres, offrant ainsi «l’esthétique biologique que je cherchais», dit Defibaugh.
Son média, cependant, est devenu aussi menacé que ses sujets après que Polaroid ait cessé la production de ses films instantanés en 2008, lors de sa deuxième faillite. Il ne reste plus que huit boîtes dans la réserve personnelle de Defibaugh (il a déjà acheté un étui à un ami photographe), qu'il range dans un réfrigérateur.
Lors du traitement du film, il fait davantage preuve de laisser-faire, abandonnant le contrôle du développement du négatif à la chimie en s'écartant de la méthode recommandée par Polaroid.
Dans le type 55, un papier récepteur photographique et un film négatif photosensible sont intercalés dans un manchon avec une nacelle de réactifs, un paquet de produits chimiques à consistance gélatineuse à une extrémité. Après exposition, le photographe passe le manchon à travers une paire de rouleaux métalliques qui ouvrent la nacelle et étalent uniformément un révélateur, un solvant à base d’argent et d’autres produits chimiques, entre la feuille et le négatif.
Ce qui suit dans la minute qui suit environ le développement (le temps exact dépend de la température ambiante) est un peu mystérieux, car les processus de Polaroid étaient propriétaires. Ce que l’on sait, c’est un processus de transfert par diffusion, dans lequel l’argent exposé à la lumière reste immobilisé dans le négatif, et les halogénures d’argent non exposés (ou sels d’argent) se déplacent de la surface du négatif à la couche réceptrice du côté à imprimer. Là, ils réagissent avec des produits chimiques pour former l’image positive en argent métallisé noir.
Lorsque le temps est écoulé (Defibaugh attend une minute supplémentaire pour obtenir un meilleur contraste), le photographe détache le Polaroid pour en faire ressortir une impression en noir et blanc et un négatif. L’impression reçoit généralement un brossage du fluide protecteur du polymère, tandis que le négatif est traité en premier lieu dans une solution de sulfite de sodium qui élimine tous les produits chimiques restants, puis dans un bain-marie et enfin un fixateur empêchant les dommages à la surface fragile de la gélatine.
«Lavez et séchez et vous obtenez un magnifique négatif plein ton qui produira de fines impressions en noir et blanc», déclare Defibaugh.
Pour transformer l'efficacité finement ajustée de Polaroid en art organique, il s'écarte de ce protocole en sautant le processus de clarification post-développement. Au lieu de cela, il permet «à tous ces produits chimiques et produits résiduels de compoter sur le négatif et, avec les polluants atmosphériques, d'attaquer l'argent et le liant à la gélatine dans lequel il est suspendu», déclare Alice Carver-Kubik, chercheuse en photographie au Image Permanence Institute de RIT. qui connaît le travail de Defibaugh.
Elle attribue des dépôts cristallins épais aux produits chimiques persistants de la capsule de réactifs, tandis que les bulles et les canaux sont dus à la gélatine qui se replie de son support en plastique, donnant au négatif une surface tactile. Les colorants anti-halo restants (qui empêchent la lumière de se réfracter pendant l'exposition) sont responsables d'un plâtre gris foncé, avec une couche de jaune provenant de la gélatine détériorée.
Parce que Defibaugh place les négatifs séchés dans des manches, ils s'oxydent de la même manière que sur les photographies montées dans des livres ou des piles d'air qui s'infiltrent de l'extérieur, souligne Carver-Kubik. «Lorsqu'elles sont numérisées, beaucoup d'entre elles présentent des couleurs bleu et orange sur les bords et parfois plus fortement sur le dessus et les côtés, comme chez le canard du Labrador», explique-t-elle, comparant les tons à ceux des daguerréotypes.
«Je regarde ce processus et numérise le négatif en RVB [couleur] une fois que le film s'est dégradé et a pris une apparence patinée, cristallisée et stratifiée après environ 6 à 12 mois», explique Defibaugh. Le négatif continuera à se décomposer en noirceur totale.
Capturer les images avec la technologie très numérique qui a contribué à la disparition de la société de films instantanés Polaroid n’est que l’une des nombreuses ironies du projet «Afterlifes». Prenez les spécimens eux-mêmes, qui sont, selon la déclaration de l'artiste de Defibaugh, «forgés avec contradiction».
Pour créer un spécimen, les animaux sont sacrifiés, mais leur corps préparé peut continuer à exister presque indéfiniment, dans des conditions de stockage idéales (certains spécimens du Smithsonian datent des années 1800). Sous leur nouvelle forme, les animaux décédés donnent vie à des études scientifiques., notamment de la biodiversité.
«Cette collection est une bibliothèque sur la biodiversité», explique Christina Gebhard, spécialiste des musées de la division des oiseaux du Musée national d'histoire naturelle, qui a servi de contact avec Defibaugh. "Chaque spécimen est essentiellement un instantané dans le temps."
Defibaugh capture non seulement un moment dans l'existence de chaque spécimen, mais plus tard, numériquement, la détérioration de cette image. «Cette dualité de préservation et de dégradation est au cœur de ces photographies», a déclaré Defibaugh, qui espère poursuivre son projet au Peabody Museum of Natural History de Yale et au American Museum of Natural History de New York.
Gebhard, pour sa part, est heureuse que Defibaugh présente le canard ou le grand pingouin du Labrador rarement vu à un public plus large, en particulier à ceux qui ne risquent pas d'être confrontés à une perte de biodiversité dans leur vie quotidienne.
«Les gens peuvent faire rapidement le lien entre son choix d'un milieu à vie courte et les espèces disparues qui se sont estompées avant que nous ayons eu un concept de conservation», dit-elle.