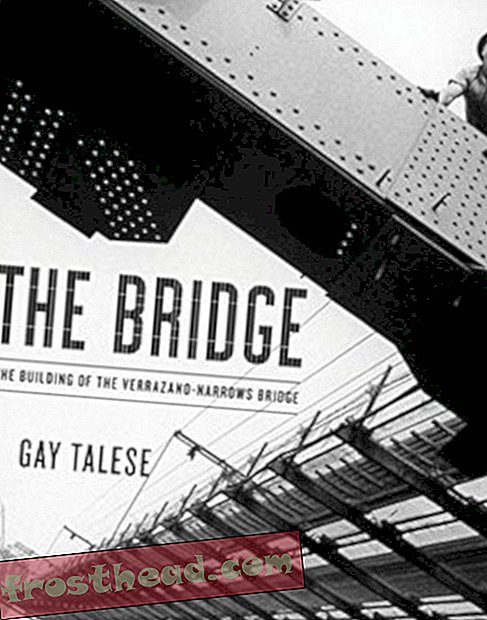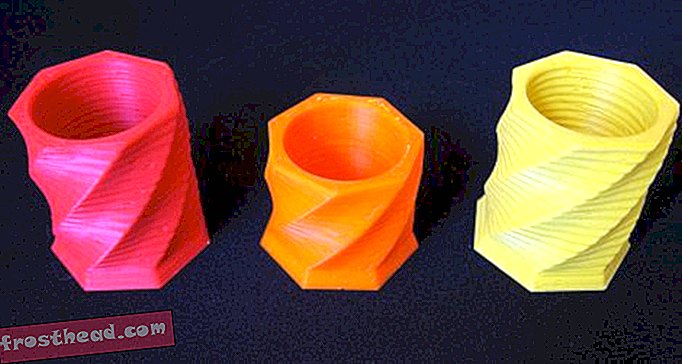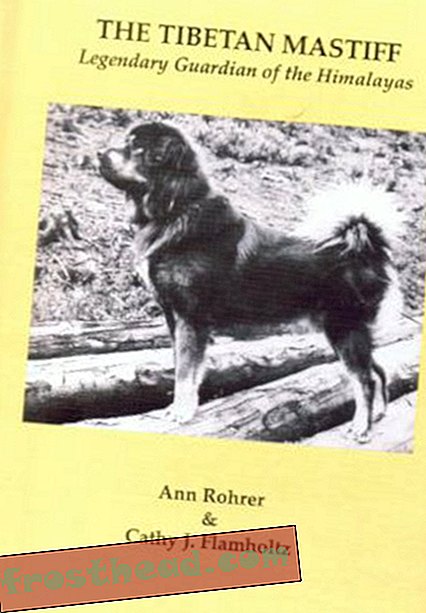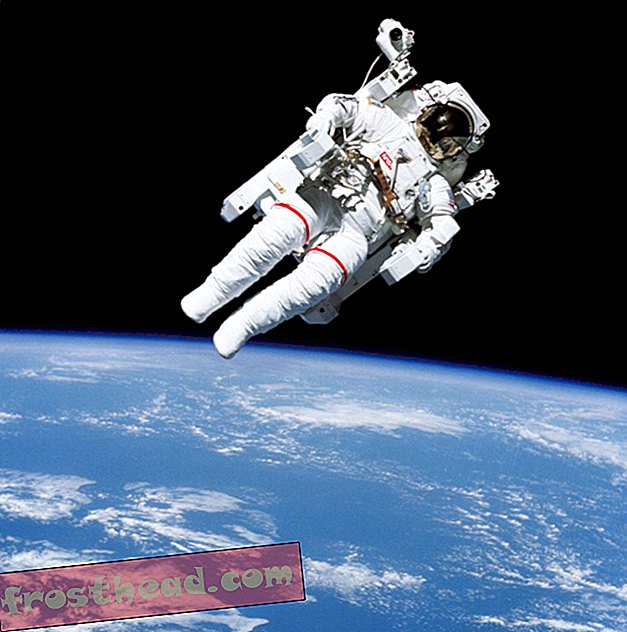Cape et Dollar: une histoire de l'intelligence secrète américaine
Rhodri Jeffreys-Jones
Yale University Press
Au cœur d'un débat national sur l'incapacité de notre service de collecte de renseignements à empêcher les attaques terroristes du 11 septembre, on peut lire l'évaluation cinglante de l'historien Rhodri Jeffreys-Jones de l'espionnage américain, de la Révolution à nos jours. L'auteur allègue que les agences de renseignement ont traditionnellement "tendance à se déchaîner avec l'argent des contribuables", alors que la récente rivalité entre agences a nui à l'efficacité. Cela a coûté cher aux États-Unis, une perception rendue opportune par les révélations selon lesquelles le FBI était préoccupé par les étudiants du Moyen-Orient dans les écoles de pilotage américaines et ne s'était jamais inscrit aux plus hauts niveaux du FBI ou de la CIA.
Jeffreys-Jones, professeur d'histoire américaine d'origine galloise à l'Université d'Édimbourg, en Écosse, et auteur de deux ouvrages précédents sur la CIA, estime que le service du renseignement est plus compétent en auto-promotion que pour le spycraft.
Il adopte une vision à long terme, commençant dans les premières années de la République, lorsque la population de tout le pays était inférieure à celle de l'Irlande et que la colonisation à l'ouest de l'Irlande ne s'étendait pas beaucoup au-delà des Appalaches. En 1792, le président George Washington dépensa pas moins d'un million de dollars, soit 12% de l'ensemble du budget fédéral, dans ce que le Congrès appelait primitivement un "fonds contingent de relations étrangères", c'est-à-dire un espionnage contre les Britanniques au Canada et les Indiens à l'ouest. .
Nous rencontrons des personnalités à demi oubliées telles qu'Allan Pinkerton, l'ancien radical écossais devenu détective privé, dont l'opération d'infiltration a sauvé Abraham Lincoln de l'assassinat alors qu'il se rendait à sa première inauguration en 1861. Pinkerton a ensuite exercé une incompétence manifeste en tant que chef du renseignement L’armée de l’Union et l’influence grossière des troupes de la Confédération lui ont permis de prolonger la guerre. Nous rencontrerons également le cryptographe HO Yardley, qui joue très fort au poker et qui a déjà été honoré pour avoir enfreint le code diplomatique japonais dans les années 1920. Plus tard, il vendit ses compétences aux Japonais, contribuant probablement à leur capacité à lancer l'attaque surprise de Pearl Harbor en 1941.
Quant au FBI, qui a commencé à enquêter sur des affaires de fraude foncière et d’antitrust, il a semblé indispensable en inventant une épidémie de "cas d’esclavage blanc". (Le bureau a affirmé que de jeunes femmes américaines avaient été enlevées et vendues à des maisons de prostitution.) Plus tard, l'agence a tenté de discréditer Charles Lindbergh, dont les déclarations isolationnistes menaçaient de saper le soutien américain à l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale, en alléguant qu'il fréquentait des prostituées et volait du whisky. aux États-Unis à partir du Canada pendant la prohibition. L'épisode nous rappelle que la désinformation a toujours été l'un des outils les plus pointus du métier de l'espion.
Jeffreys-Jones appelle les années 1950 "l'âge d'or des opérations et du battage médiatique". De 1949 à 1952 seulement, la division des actions secrètes de la CIA est passée de 302 à 2 812 membres du personnel. C’était une époque où les responsables de la CIA, "munis de leurs cartes d’identité et ressemblant au groupe de Yale", informaient régulièrement les journalistes revenant de mission à l’étranger. C'était aussi un moment où la CIA avait organisé la défaite des insurgés de gauche aux Philippines et renversé des gouvernements populaires en Iran et au Guatemala. En 1961, l’agence menait les États-Unis à la débâcle de la baie des Cochons. (Ce chapitre commence par le récit d'un dîner organisé en 1960, lors duquel le président John F. Kennedy fut invité à demander au romancier Ian Fleming, créateur de James Bond, des idées sur le renversement de Fidel Castro; un Flamand amusé suggéra de raser la barbe de Castro. de l’émasculer.) L’échec le plus flagrant de l’agence, cependant, est peut-être son incapacité à prévoir l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Le sénateur Daniel Patrick Moynihan, par exemple, a accusé l'agence d'avoir surestimé de 300% la taille de l'économie soviétique.
Les fanfarons du passé seraient sans doute anéantis de savoir que le club des hommes autrefois exclusivement réservé aux hommes, principalement composé d'hommes, principalement de l'Ivy League et qui dirigeait la CIA, a ouvert ses portes à la société plus diversifiée d'aujourd'hui. En 1995, une femme, Nora Slatkin, a été nommée au troisième rang des postes de l'agence.
Après la chute du mur de Berlin, des critiques ont appelé à une réduction de l'ampleur des services de renseignement de la nation. Aujourd'hui, les événements du 11 septembre ont recentré l'attention sur l'importance de l'espionnage pour la sécurité nationale. Le FBI et la CIA réclament des augmentations de financement. Toutefois, prévient l'auteur, aucune agence de renseignement, aussi bien aménagée soit-elle, ne peut garantir totalement la sécurité des citoyens qu'elle est chargée de protéger. Les développements récents ne semblent pas non plus indiquer que l’Amérique ne peut pas toujours compter sur la compétence de son établissement d’espionnage.
Le critique Fergus M. Bordewich est un journaliste qui a beaucoup écrit sur les affaires étrangères.
La tapette à mouches: comment mon grand-père s'est fait connaître dans le monde
Nicholas Dawidoff
Panthéon
En tant qu'immigrant américain aujourd'hui, Alexander Gerschenkron pourrait se retrouver en train de conduire un taxi. Mais à une époque antérieure à l'académie, cédant au credentialisme, un homme comme Gerschenkron, titulaire d'un diplôme en économie - mais pas d'un doctorat - de l'Université de Vienne, pouvait toujours devenir professeur à Harvard. Là, à partir des années 1950, il influencerait une génération d'historiens économiques. Il se verrait également proposer des postes dans les études slaves et la littérature italienne (postes qu’il aurait refusés) et s’enseignerait lui-même le sport islandais. Il a joué aux échecs avec l'artiste Marcel Duchamp, a flirté avec l'actrice Marlene Dietrich et s'est disputé avec son collègue John Kenneth Galbraith, parmi d'autres adversaires illustres.
Le biographe et petit-fils de Gerschenkron, Nicholas Dawidoff, tire son titre, The Fly Swatter, de la tendance de son grand-père à appliquer une énergie féroce, une sorte d'overkill psychique, à de grands ou petits efforts. Prenez, par exemple, le contrôle des insectes. "Certains hommes tuent juste une mouche", écrit Dawidoff. "Mon grand-père avait un arsenal de chasseurs ... [Il] n'a jamais permis à ses victimes d'être nettoyées. Il a prétendu qu'elles étaient dissuasives."
La contribution majeure de Gerschenkron à l'économie consistait à mettre l'accent sur la manière dont l'adversité pouvait contribuer au développement d'un pays, processus qui reflétait sa propre vie. Il a fui les communistes après la révolution russe de 1917. Après s'être reconverti en viennois, il a fui les nazis en 1938 et a émigré en Amérique.
Au début, il balayait les sols et travaillait dans un chantier naval, avant de se faire embaucher comme conférencier à Berkeley. En 1948, au milieu de la quarantaine, il décroche le poste de Harvard. Déterminé à démontrer ses capacités singulières, l'instructeur entraîné commença une période où il "ne dormait que tous les soirs et invitait ceux qui souhaitaient un mot avec lui à passer à son bureau à six heures du matin".
Il a acquis une renommée en tant qu’économiste brisé qui connaissait «tout sur tout: l’historiographie allemande, la théorie de l’émigration dans l’histoire de la Roumanie, la complexité d’un temps infiniment divisible. Il comprenait mieux Kant, Tchekhov, Aristote et Schopenhauer que ceux qui les enseignaient à Harvard " Il avait peut-être 20 langues à sa disposition.
Le livre de Dawidoff est à la fois une étude de l'expérience d'immigrant et une image vivante de la vie intellectuelle au milieu du siècle de la plus prestigieuse université américaine. Mais il s’agit avant tout d’un portrait émouvant d’un individu complexe et incroyablement érudit, écrit par l’une des rares personnes à qui il a permis de toucher son cœur. L'auteur, accompagné de sa sœur et de plusieurs cousins, a passé les étés de son grand-père dans le New Hampshire, rappelle Dawidoff avec un sentiment de profonde affection: "Chaque nuit, il nous cachait tous et nous glissait chacun un morceau de chocolat au lait non emballé. Il a dit que c'était notre récompense pour le brossage de nos dents. "